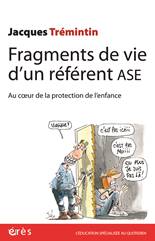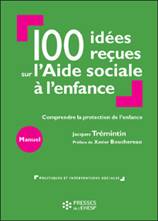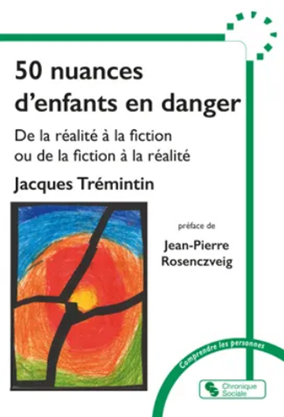Tyrannie des chiffres
-
dans Billets d'humeur
Les chiffres sont toujours manipulables. Qu’ils le soient par des gens mal intentionnés, pour des causes douteuses, n’étonne pas. C’est plus gênant, quand il s’agit de combattre des injustices.
Un colloque tenu en 2013 donna la terrible information de 810 décès d’enfants maltraités par an. Les media en firent un slogan : « deux enfants tués par jour ». Une étude menée en 2017, par trois inspections générales gouvernementales, rétablira la proportion d’un enfant tous les cinq jours.
L’année suivante, en 2014, Laurence Rossignol, alors secrétaire d’Etat, prétendit que 80% des enfants placés l’étaient non pour de la maltraitance, mais à cause de la crise. En 2000, le rapport Naves Cathala avait pourtant fait justice de cette affirmation : « aucun des enfants accueillis provisoirement ou placés, dont la mission a examiné la situation, n’a été séparé de “son milieu actuel” du seul fait de la pauvreté de ses parents. » Mais non, quinze ans après, l’infox perdurait.
Et puis, voilà qu’un nouveau chiffre a fait récemment son apparition : « 80 % des femmes porteuses de handicap sont victimes de violence ». La source ? Un rapport de l'OMS de 2012 qui dit juste que « les femmes handicapées font l’objet de violences au moins une fois et demi de plus que les autres femmes ». Le nombre de femmes victimes dans le monde est évalué à 30 %. Ce qui ferait 45 %, pour celles en situation de handicap.
D’autres études fondées justement sur leur seul déclaratif sembleraient confirmer cette évaluation. Ne peut-on pas s’interroger sur les biais venant relativiser ces témoignages rétrospectifs ? Biais d’attention : surestimer certains éléments mémorisés à partir de ce que l’on veut trouver. Appel à la probabilité : comment la question est-elle posée par un chercheur voulant prouver la réalité de son hypothèse ? Le bien d’attribution hostile : partant de la conviction d’une situation d’agression, le geste sera interprété comme tel. Biais de confirmation : ne retenir que les éléments venant vérifier son hypothèse. Biais de représentativité : regrouper tous les actes identifiés sous le même vocable sans les hiérarchiser, ni nuancer leur importance respective pour la victime.
Que faut-il en déduire ?
Le questionnement de ces chiffres n’équivaut pas à dénier, négliger ou minimiser ce qu’ils dénoncent. Des agressions sexuelles contre les femmes en général et celles plus vulnérables car porteuses de handicap doivent être une priorité des travailleurs sociaux.
Notre détermination à combattre cette terrible réalité ne peut être proportionnelle au nombre d’enfants mourant sous les coups, au facteur de la misère pesant sur leur placement ou au pourcentage de femmes victimes parce qu’handicapées. Mais, le sensationnel, l’incroyable ou l’émotion ne sont pas la bonne voie pour mobiliser les consciences. Et le mésusage des chiffres qui est alors instrumentalisé à cet effet est contre-productif et dessert la cause qu’il entend défendre. A l’image de ce stagiaire éducateur spécialisé, confiant son désarroi face à un public handicapé, incité à voir dans 80% des femmes le composant des personnes ayant subi une agression sexuelle.
Accueillons la parole des plus fragiles avec bienveillance mais aussi respect. Ne projetons pas sur elle nos préjugés, stéréotypes et représentations idéologiques. Prenons ce qui se dit et non pas ce qu’on voudrait qu’elle nous dise.