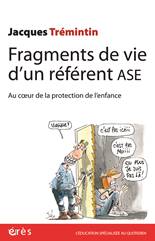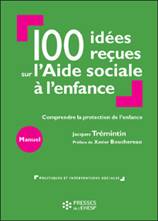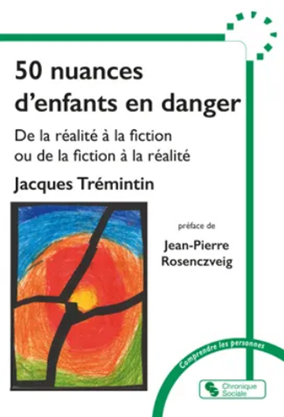Le temps qui passe
-
dans Billets d'humeur
En ce 1er janvier 2024, le calendrier change d’année. Le compte à rebours avant minuit du 31 décembre et les klaxons après les premières secondes du Nouvel An sont rentrés dans la tradition.
Au point de penser qu’il en a toujours été ainsi. Il suffit de consulter la page Wikipedia (1) pour constater combien la date scandant le passage d’une année sur l’autre « a beaucoup changé au fil des siècles pour les peuples usant du calendrier solaire, et ce, au gré des Églises, des époques et des pays. » C’est, en fait, avec l’édit de Roussillon promulgué le 9 août 1564, que le Roi Charles 9 stabilise ce basculement au 1er janvier.
L’occasion de s’interroger sur la relativité du temps qui passe en général et celui du travail social en particulier. Le temps de l’institution ou des professionnels n’est pas forcément celui des usagers. On retiendra, à cet effet, l’intérêt du distinguo que font ses auteurs dans un livre récent (2) entre deux concepts utilisés dans l’antiquité grecque.
Le terme « chronos » désigne un temps linéaire objectivable et mesurable, celui du calendrier. Le « kairos » privilégie quant à lui l’opportunité à saisir, le moment adéquat, l’occasion propice permettant d’ajuster l’accompagnement.
D’un côté, donc, chronos avec ses échéances (synthèses, bilans, dates anniversaires de la signature du projet individualisé, renouvellement de prise en charge ou fin du délai d’accueil, du contrat, de l’engagement réciproque …), mais aussi le déroulement d’une mesure (structurée autour d’objectifs dont on cherche à mesurer les résultats concrets).
De l’autre côté, le kairos mettant en relation le travailleur social et la personne qu’il accompagne, tissant un lien propice à des avancées dont on ne peut toutefois fixer à l’avance le délai de concrétisation. Des actions sont menées, sans que l’on puisse en connaître le terme. Ce n’est pas forcément quand ils ont été programmés que les effets escomptés surviendront. Le changement est aléatoire et imprévisible. Il peut s’avérer rapide ou très lent, progressif ou subit, étalé ou ponctuel. Il peut arriver que ce qui semblait acquis se délite brusquement et ce qui semblait stagner s’avère en fait avoir progressé à bas bruit bien plus qu’on ne pouvait s’y attendre. Cette énigme fait partie intégrante de l’équation de l’accompagnement.
Tenter d’en mesurer l’efficience est problématique pour tout professionnel qui ne se contente pas du requis et du formel mais s’ouvre sur le réel et ses inévitables revirements. Assurer la continuité d’une action n’est une dimension ni comptable, ni comptabilisable au regard des exigences des financeurs attendant un retour sur investissement.
Cet écart entre ces deux temporalisations est parfois difficile à argumenter par les praticiens et tout autant malaisé à comprendre pour quiconque n’est pas familier du terrain. Il est essentiel néanmoins de le revendiquer et de l’appliquer. Ce, quelle que soit date à laquelle l’on fixe des échéances ! Finalement, cet instant qui est censé faire basculer un accompagnement est aussi artificiel que le passage d’une année à une autre. Si on ne peut y échapper, ce n’est là qu’une convention.
(1) https://fr.wikipedia.org/wiki/Jour_de_l%27an
(2) https://tremintin.com/joomla/livres/action-sociale-et-educative/travail-social/4581-le-travail-social-en-mouvement-de-la-crise-a-l-innovation